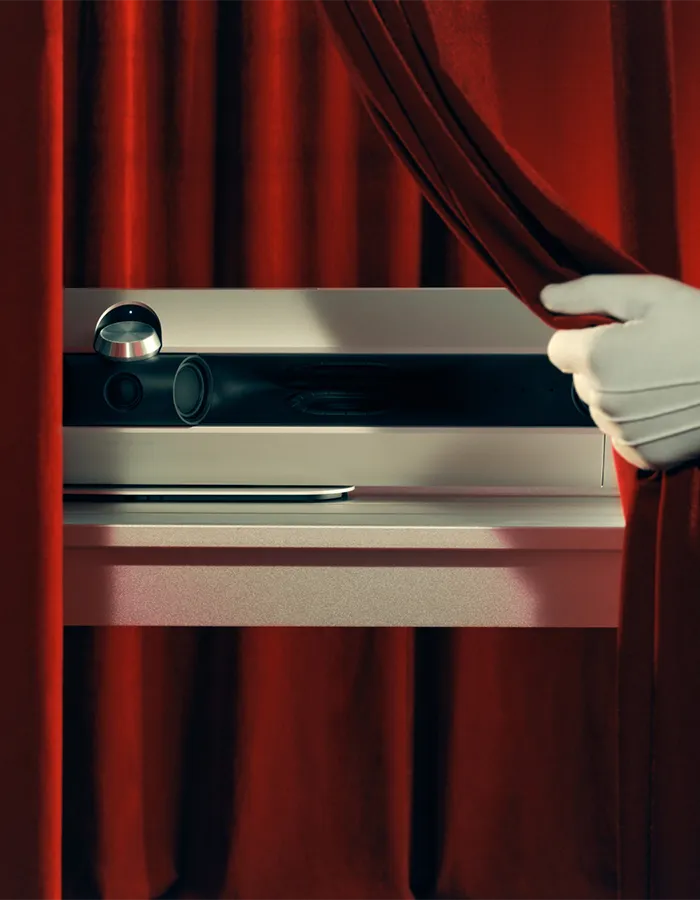Il y a, dans les œuvres de Julian Diaz, une lumière discrète, presque ancienne. Elle semble naître de l’intérieur du bois, comme si chaque fibre retenait encore un souffle, un secret, une pulsation venue du temps où l’arbre était vivant, debout. Né en Argentine et installé à Toulouse, l’artiste ne sculpte pas tant qu’il écoute. Il s’approche de la matière comme on s’approche d’une présence, attentivement et silencieusement, pour en traduire le plus léger frémissement.


Son travail s’inscrit dans cet espace fragile où l’art, le design et l’architecture s’effleurent. Pourtant, c’est la matière – brute, sensible, indocile – qui en demeure l’unique point d’origine. Dans le chêne et le frêne français, Julian Diaz cherche moins la forme que la mémoire : une trace enfouie, un mouvement oublié, une vibration prête à renaître. Sous la lame du ciseau, le bois se laisse révéler comme un paysage intime ; sous le feu du shou sugi ban, il s’ouvre, se fissure, se consume avec dignité, retrouvant une noirceur minérale qui lui confère la gravité des pierres et des terres anciennes.
Chaque pièce est une rencontre. Une lente négociation entre la volonté du geste et la résistance du matériau. Le bois se creuse, se tend, se plisse, évoquant tour à tour la peau d’un animal mythique, le lit d’un fleuve asséché, une croûte terrestre en devenir. Dans ces sculptures et ces meubles habités, quelque chose palpite encore. Une énergie sourde, presque organique, semble circuler dans les veines du matériau, comme si l’artiste avait su capter son dernier souffle pour le transformer en présence.


Dans cet univers où les formes se dépouillent de tout artifice, la beauté surgit de l’imperfection : une asymétrie assumée, une brûlure, un relief chaotique que la main n’a pas voulu dompter. Julian Diaz célèbre ce qui échappe, ce qui résiste, ce qui refuse la perfection lisse. Ses œuvres ne décorent pas un espace : elles l’augmentent, le ralentissent, l’ouvrent à une profondeur inattendue. Leur simplicité apparente n’est jamais minimaliste ; elle est essentielle.
Les collaborations qu’il a menées avec Laura Gonzalez ou le studio Caprini & Pellerin témoignent de cette capacité à inscrire ses pièces dans des lieux où le bois, redevenu presque rituel, dialogue avec des architectures, des ombres et des volumes. Son travail voyage aussi dans les foires et salons, où chaque sculpture semble transporter un fragment de forêt, une part de nuit, une chaleur ancienne. Latidos, récemment présenté au salon Estampa de Madrid, apparaît comme le cœur battant de cette démarche : une pièce brûlée, sculptée, où l’on croit entendre un pouls profond, celui de la matière elle-même.
Face aux œuvres de Julian Diaz, le temps se modifie. On ne regarde pas : on respire avec elles. Elles invitent à une forme d’attention rare, à un retour vers le tact, la lenteur, la terre. Elles rappellent que le bois, avant de devenir objet, fut un être vivant, traversé par la lumière, l’eau et le vent. En sculptant cette mémoire, l’artiste ne façonne pas seulement des formes : il fait surgir des émotions tangibles, des fragments d’origine.