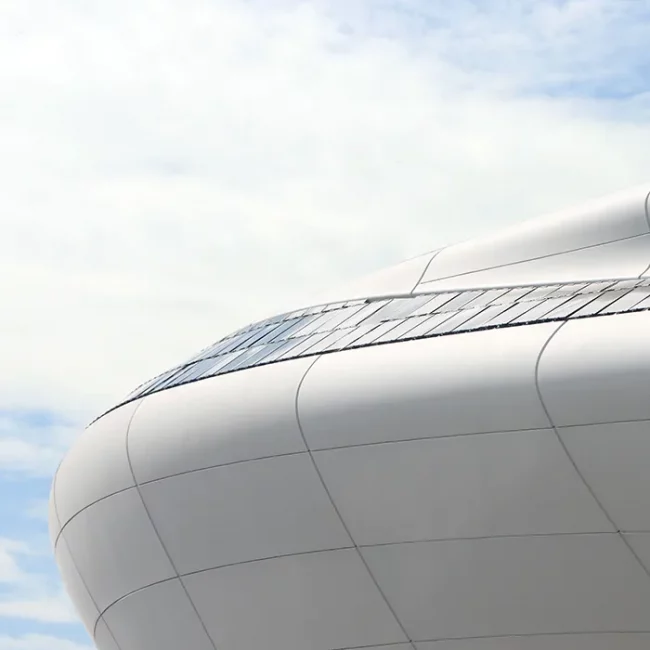De Jouy-en-Josas à Raspail, et bientôt au Palais-Royal : la Fondation Cartier pour l’art contemporain écrit une nouvelle page de son histoire architecturale. Jean Nouvel, maître d’œuvre de ses deux dernières métamorphoses, orchestre le passage d’un écrin translucide à une structure modulable au cœur du tissu haussmannien. Enquête sur un changement d’échelle, de contexte et de vision.

Quand la Fondation Cartier quittera son emblématique bâtiment de verre du boulevard Raspail fin 2025, elle ne tournera pas seulement une page géographique, mais bien architecturale et symbolique. Installée depuis 1994 dans un édifice imaginé par Jean Nouvel comme une utopie de transparence, l’institution s’apprête à réinvestir un lieu chargé d’histoire, à deux pas du Louvre, place du Palais-Royal. Une opération de réancrage culturel dans le tissu haussmannien parisien, dirigée une fois encore par Jean Nouvel. À la clef : un espace d’exposition réinventé, au croisement de l’héritage patrimonial et de l’innovation muséographique.Le bâtiment du boulevard Raspail, livré en 1994, fut salué comme une prouesse architecturale : une structure diaphane de 1 200 mètres carrés, presque sans murs, entièrement modulable, conçue comme un espace de liberté pour les artistes. Nouvel y abolit la frontière entre intérieur et extérieur, en écho au jardin « Theatrum Botanicum » de Lothar Baumgarten. Mais ce geste radical, longtemps célébré pour la flexibilité scénographique qu’il a engendrée, révèle aujourd’hui ses limites. À l’épreuve du temps et des ambitions croissantes, le lieu s’avère contraint : en capacité, en accessibilité, en adaptation aux technologies muséales récentes.
Pourquoi déménager ? Le déplacement de la Fondation Cartier ne relève pas d’un caprice, mais d’un recentrage stratégique. Situé au 2, place du Palais-Royal, le nouveau site prend place dans l’ancienne structure du Grand Hôtel du Louvre, qui abrita ensuite les Grands Magasins du Louvre, avant d’héberger le Louvre des Antiquaires. Cet ensemble, inauguré en 1855 dans le cadre des réaménagements haussmanniens impulsés par Napoléon III, dialogue frontalement avec le Louvre. Un site prestigieux, mais contraignant : comment y incorporer une architecture d’avant-garde sans heurter la mémoire de la pierre ?
Jean Nouvel répond par une œuvre de greffe et de friction. Il imagine un bâtiment d’exposition inséré dans l’existant, un alliage assumé avec l’épaisseur historique. Les baies vitrées courant le long des façades sur la place du Palais-Royal, la rue de Rivoli et la rue Saint-Honoré révèlent au passant une scénographie en mouvement. À l’inverse de Raspail, ici, la transparence n’est plus un manifeste ; elle est une strate parmi d’autres, un palimpseste.
Le nouveau bâtiment s’étend sur 8 500 mètres carrés accessibles au public, dont 6 500 de surfaces d’exposition. Nouvel y introduit une innovation majeure : cinq plateformes mobiles – 1 200 mètres carrés au total – permettant de moduler les volumes et les hauteurs, jusqu’à 11 mètres, au gré des œuvres et des artistes. Le dispositif crée un espace dynamique, sans fixité : les parcours deviennent des trajectoires, les plafonds se lèvent ou s’effacent. Le bâtiment se pense comme une « machine à montrer », dans la veine des expositions de Cedric Price ou du centre Pompidou des débuts.
Les coursives de 1 200 mètres carrés offrent des points de vue latéraux, brisant l’uniformité du regard frontal. Le spectateur est toujours en mouvement, à la fois surplombant, immergé ou latéralisé. Une scénographie architecturale qui répond à la diversité des pratiques artistiques contemporaines, de l’installation immersive à la performance.
Si Jean Nouvel fut visionnaire en 1994, il se fait chirurgien en 2025. Là où Raspail proclamait la dissolution des limites, le Palais-Royal explore leur reconfiguration. Dans les deux cas, le geste architectural épouse le projet artistique : offrir un espace de liberté et de transformation. Nouvel ne réplique pas Raspail, il le dépasse en intégrant la variable patrimoniale et en introduisant une spatialité mécanisée.
De ses propres mots, « un lieu comme celui-ci demande de l’audace, un courage que les artistes ne manifesteraient peut-être pas dans d’autres lieux institutionnels ». Ce qu’il invente ici ne se lit pas uniquement dans le béton ou la pierre, mais dans le système d’exposition lui-même, dans sa capacité à accueillir l’imprévisible.
En quarante ans d’histoire, la Fondation Cartier aura évolué en trois temps : d’abord laboratoire à Jouy-en-Josas, puis proclamation à Raspail, et enfin infrastructure mutante au Palais-Royal. À chaque étape, l’architecture a incarné une forme d’engagement : pour la liberté artistique, pour la transversalité des disciplines, et pour l’invention de nouveaux modèles d’exposition.
2, place du Palais-Royal, Paris 1er